Le site « Contre attaque » vient de publier un article (que nous republions sur ce site) sur la journée internationale du 25 novembre, mettant en avant, à juste titre, quelques figures féminines remarquables. Toutefois nous sommes en désaccord avec quelques appréciations portées sur la manifestation menée par les ouvrières du textile des faubourgs de Vyborg à Petrograd le 8 mars 1917. Elles manifestent contre le rationnement du pain, sont rejointes par 150 000 ouvriers qui seront déterminant dans la création du 1er Soviet. Dire que les femmes déclenchent la révolution russe c’est un gros raccourci de l’histoire, bien d’autres circonstances vont permettre la révolution de février 17. Nous citons en fin d’article un extrait d’article d’octobre 2017 du Monde Diplomatique qui le démontre.
Histoire : pour un 25 novembre féministe, révolutionnaire, anti-impérialiste et antimilitariste
(https://contre-attaque.net/2025/11/22/histoire-pour-un-25-novembre-feministe-revolutionnaire-anti-imperialiste-et-antimilitariste/)
«Devons-nous nous laisser entraîner lamentablement dans une guerre ? Jamais !»
Rosa Luxembourg
Le 25 novembre est traditionnellement la journée internationale de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et de genre. Et quelles plus grandes violences que celles engrangées par la guerre ? Cette guerre dans laquelle les femmes dans l’histoire ont toujours été en première ligne, malgré le récit dans lequel on a voulu les enfermer.
À l’approche de cette journée de lutte, nous vous proposons de nous inspirer de femmes qui se sont élevées contre l’impérialisme et le militarisme. Ahed Tamimi, pour la libération de la Palestine
Le 15 décembre 2017, une vidéo fait le tour des réseaux sociaux. On y voit une Palestinienne de 16 ans bousculer et gifler des soldats israéliens armés de fusils d’assaut à Nabi Saleh, en Cisjordanie occupée. Donald Trump vient alors de reconnaître Jérusalem comme capitale de l’entité génocidaire israélienne, déclenchant des manifestations dans la Palestine occupée et partout dans le monde.
Cette jeune femme courageuse, c’est Ahed Tamimi. Son cousin Mohammad vient de se prendre une balle en caoutchouc dans la tête, amenant les médecins à l’opérer et lui enlever une partie du crâne. Durant les deux années précédentes, Ahed Tamimi a été impliquée dans cinq autres altercations avec les colons génocidaires, dont une dès ses 14 ans lorsqu’elle avait mordu un soldat israélien cagoulé pour défendre son frère plaqué au sol lors d’une tentative d’arrestation.
Ahed est arrêtée le 19 décembre 2017 avec sa mère Nariman et sa cousine Nour. Avec 12 chefs d’inculpation, elle est condamnée à 8 mois de prison et est libérée en juillet 2018. «Nous ne sommes pas des victimes mais des artisans de la liberté» expliquait-elle lors de sa venue à la Fête de l’Humanité en 2018.
Le 6 novembre 2023, elle est de nouveau arrêtée par l’armée israélienne lors d’un raid en Cisjordanie occupée. Elle sera relâchée quelques semaines plus tard dans un échange avec des otages israéliens. Icône de la résistance palestinienne, un portrait géant d’Ahed a été peint sur le mur de séparation israélien.
Rosa Luxemburg : «Guerre à la guerre !»
«À bas la guerre ! À bas le gouvernement !» scandait Rosa Luxemburg le 1er mai 1916, alors que l’Allemagne était engagée dans un conflit sanglant. Cette terrible guerre des tranchées, qui n’était qu’un massacre entre puissances impériales pour la domination des marchés et colonies, mais pour laquelle des millions de prolétaires ont été envoyés à la boucherie. Dès le début de la guerre, Rosa Luxembourg se livre à une critique du militarisme, dénonce la trahison du SPD – le parti socialiste allemand – que représente sa participation à l’Union sacrée et son vote des crédits de guerre. Elle fonde la ligue spartakiste avec son compagnon Karl Liebknecht, une ligue résolument antimilitariste et révolutionnaire, appelant à l’unité des travailleurs européens.
Dans son livre L’accumulation capitaliste, Rosa Luxembourg met en lumière le lien entre surproduction capitaliste, impérialisme et course à l’armement. «Le militarisme assure, d’une part, l’entretien des organes de la domination capitaliste, l’armée permanente, et, d’autre part, il fournit au capital un champ d’accumulation privilégié» écrivait-elle. Sa propagande anti-militariste lui vaut d’être condamnée et enfermée, sans que cela n’arrête l’infatigable théoricienne.
En 1915, elle rédige en prison un texte sous pseudonyme, connu sous le nom de brochure de Junius, dans laquelle elle décrit son programme contre la guerre impérialiste et dénonce le désastre qu’est la guerre. C’est la naissance du célèbre slogan : «socialisme ou barbarie». «Cet effroyable massacre réciproque de millions de prolétaires auquel nous assistons actuellement avec horreur, ces orgies de l’impérialisme assassin qui ont lieu sous les panonceaux hypocrites de patrie, civilisation, liberté, droit des peuples et dévastent villes et campagnes, souillent la civilisation, foulent aux pieds la liberté et le droit des peuples, constituent une trahison éclatante du socialisme».
Rosa est assassinée par des «corps francs» : d’anciens soldats d’extrême droite, commandés par le gouvernement socialiste qui réprime la révolution allemande, à la sortie de la guerre. La bourgeoisie européenne toute entière soutient alors cette répression menée par les sociaux-démocrates allemands contre les révolutionnaires, terrorisée à l’idée que le «poison rouge» ne continue à se répandre dans les pays voisins.
8 mars 1917 «À bas la guerre !», «Du pain pour les ouvriers !» : quand les femmes déclenchent la révolution russe
En Russie pendant la Première guerre mondiale, comme dans tous les pays engagés dans le conflit, les femmes ont remplacé les hommes dans les champs et dans les usines.
En 1917, elles représentent deux tiers des employé·es du textile et de l’armement. Le 8 mars 1917 (23 février selon le calendrier julien), les ouvrières du textile du quartier de Viborg, à Petrograd, descendent dans la rue pour la toute jeune Journée internationale de la femme. Excédées par cette guerre qui n’en finit plus, par les files d’attente interminables pour obtenir des rations de pain misérables, elles scandent «Du pain ! À bas l’autocratie !», «À bas la guerre !»
Pourtant, dans les jours qui précèdent, les sociaux-démocrates russes (c’est à dire les « socialistes » — note de la rédaction du site. Les Bolchévik, avec Lénine, quant à eux reprendront les mots d’ordre des femmes et des ouvriers des usines Poutilov venus massivement les rejoindre — note de la rédaction du Site) ne prévoyaient aucune action d’envergure, qu’ils pensaient prématurée. Ils n’appellent même pas à la grève. Mais les ouvrières du textile décident de passer outre, et enjoignent les métallos à les rejoindre. C’est le début de la Révolution, et cinq jours plus tard le Tsar est renversé, grâce à ces femmes qui ont marché contre la guerre.
Sylvia Pankhurst, contre le féminisme bourgeois, contre la guerre et contre le colonialisme
Sylvia Pankhurst, la fille d’Emmeline Pankhurst, célèbre Suffragette anglaise, s’engage dès 1903 aux côtés de sa mère. Son combat la conduit à de nombreux passages en prison, où elle est nourrie de force après de multiples grèves de la faim. Elle prend néanmoins rapidement ses distances avec le mouvement de sa mère, qu’elle considère comme un mouvement bourgeois et coupé des classes populaires. Elle finit par couper les ponts lors qu’arrive la première guerre mondiale.
En effet, Emmeline Pankhurst décide dès 1914 de mettre fin à leurs revendications pour «soutenir l’effort de guerre». Pour Sylvia, c’est une trahison. Elle explique que «l’Union glisse du féminisme élitiste vers le militarisme». La Fédération des suffragettes d’East London qu’elle a créée en 1912 prend son indépendance, et lance son journal : Women’s Dreadnought. Tout au long de la guerre, elle ne cesse de dénoncer dans ces colonnes le militarisme et les profiteurs de guerre. Elle participe à des meetings, des manifestations contre la guerre et lance des cantines à prix coûtant, des centres de distribution de lait, etc.
Après la guerre, l’engagement antimilitariste de Sylvia Pankhurst ne faiblit pas : elle conduit une campagne contre le fascisme italien qui triomphe, et dénonce notamment les atrocités commises par l’armée italienne qui tente de coloniser l’Éthiopie.
Il ne s’agit là que d’exemples, mais qui doivent être nos boussoles en ces temps où la propagande de guerre est omniprésente. D’autant qu’en 2025, les armées occidentales tentent de recruter des femmes, et jouent la carte du «feminism-washing » pour grossir leurs rangs.
Le 25 novembre, affirmons haut et fort que marcher contre les violences patriarcales, c’est avant tout marcher contre le capitalisme vorace, contre l’impérialisme destructeur et contre le militarisme à marche forcée.
***********
La Révolution de Février en Russie
Voilà ce qu’en disait le Monde diplomatique en octobre 2017
23-27 février (8-12 mars) 1917 (1). Les ouvrières du textile des faubourgs de Vyborg manifestent contre le rationnement du pain et sont rejointes par 150 000 ouvriers. Grève générale. La répression fait une centaine de morts et provoque des mutineries. Soldats et ouvriers se procurent des armes et occupent des points stratégiques de la ville.
2 mars (15 mars). Le tsar Nicolas II cède le trône à son frère, qui abdique à son tour.
Mars-avril. Le premier gouvernement provisoire adopte des mesures concernant les libertés fondamentales. Il se déclare favorable à la poursuite de la guerre. Plus de 600 soviets sont constitués sur le modèle de Petrograd. Des comités de soldats, d’usine, de quartier émergent dans tout le pays. Plus de 150 000 désertions.
4 (17) avril. De retour d’exil, Lénine propose trois mots d’ordre : « À bas la guerre ! », « À bas le gouvernement provisoire ! » et « Tout le pouvoir aux soviets ! ».
5 (18) mai. Six anciens dirigeants socialistes du soviet entrent au second gouvernement provisoire. Les bolcheviks s’y refusent.
18 juin (1er juillet). La grande offensive russe s’enlise. Le 2 (15) juillet, les empires centraux lancent une contre-offensive victorieuse.
3-4 (16-17) juillet. Insurrection populaire déclenchée par les marins de Cronstadt. Accusés de défaitisme en intelligence avec l’ennemi, de nombreux dirigeants bolcheviques sont emprisonnés. Lénine se réfugie en Finlande.
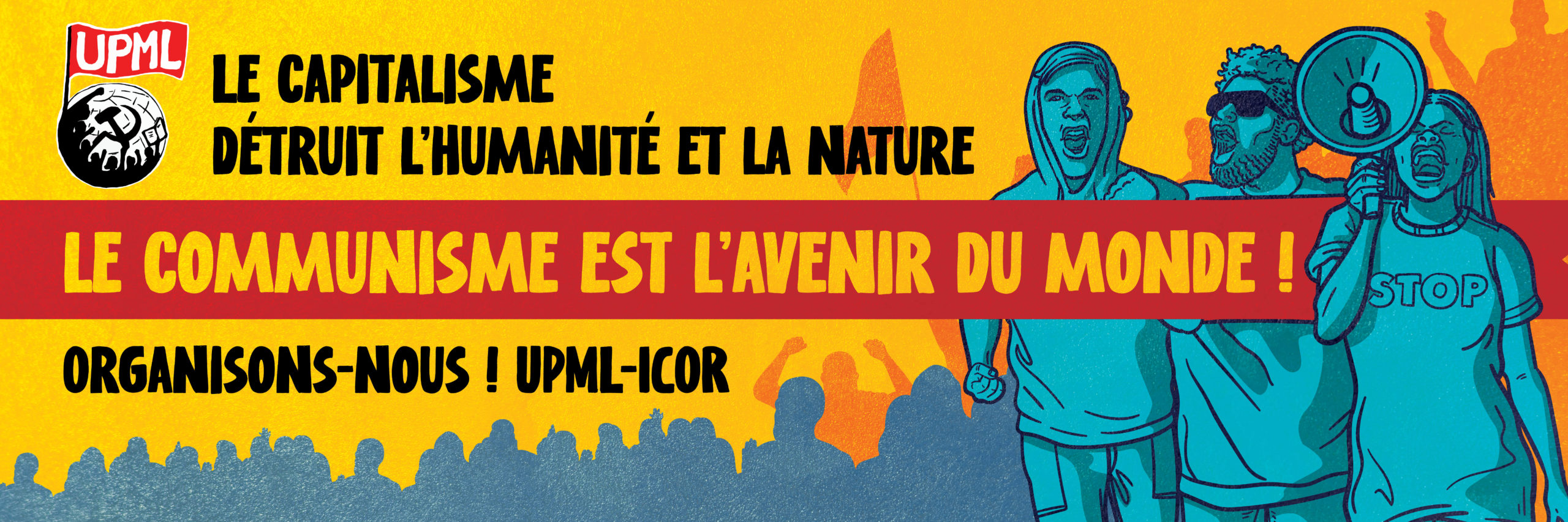
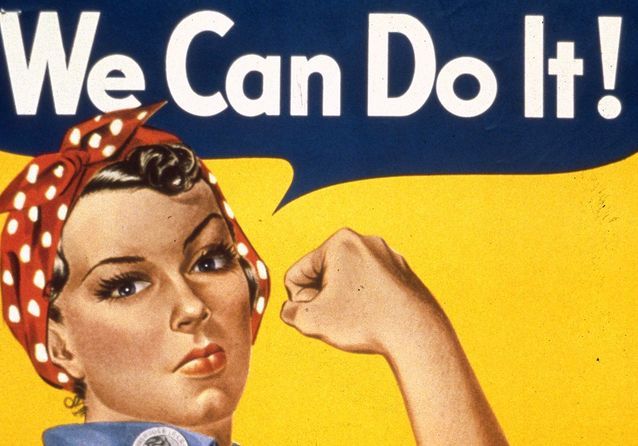

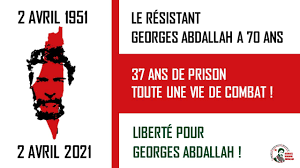

Il faudrait quand même vérifier les sources. Wikipédia n’est pas très fiable dans certains domaines….
Ahed a prouvé souvent qu’elle ne pouvait confondre ant-sionisme et anti-sémitisme. L’Union Juive pour la Paix la cite souvent et la soutien.
« En août 2025, Ahed Tamimi déclare dans un podcast notamment que « Les Palestiniens combattent les Juifs, pas seulement le sionisme », que « le judaïsme est une occupation » et que « Nous combattons les Juifs, pas le sionisme », en arrivant même à souhaiter une Troisième Guerre mondiale nucléaire qui détruise le monde entier, « pour que les Palestiniens ne soient pas les seuls à souffrir » » (Wikipédia). Ce personnage est plutôt sulfureux et ces positions sont carrément antisémites !